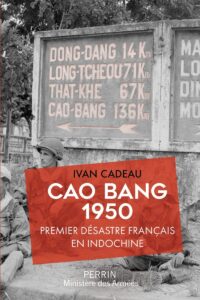
Cao Bang, c’est l’histoire de l’évacuation d’une garnison française implantée non loin de la frontière chinoise dans le nord du Tonkin, c’est-à-dire aux confins de l’actuel nord Vietnam, qui tourne particulièrement mal. Une bataille aussi appelée « bataille de la rc4 », du nom de cette route coloniale construite par les Français pour mieux contrôler les infiltrations de bandes armées chinoises. Des combats qui se sont déroulés entre les petites villes de That Khé et de Cao Bang, environ trois cents kilomètres au nord de Hanoï, dans la première quinzaine d’octobre 1950, seuls mille huit cent quarante (dont trente-neuf officiers) des cinq mille soldats engagés reviennent vivants – la catastrophe est si rapide, si surprenante, si importante qu’il est difficile de quantifier précisément les morts au combat parmi les pertes.
Dans son introduction, Ivan Cadeau fait la triste comparaison de la perception des deux grandes défaites françaises de la guerre d’Indochine, glorieuse pour Dien Bien Phu, honteuse pour Cao Bang. Avec la recherche de responsables voire de boucs émissaires, cette dernière bataille déchaîne les passions, ce qui rend le travail de l’historien d’autant plus délicat. Voilà donc l’un des grands mérites de l’auteur : tenter de dépassionner l’analyse des événements, décrire la bataille et ses coulisses sans tomber dans le piège de la description du déplacement du grenadier voltigeur dans les calcaires recouverts par la jungle. Pour nous aider à comprendre cette bataille, il retrace rapidement les conditions de l’implantation française autour et le long de cette fameuse rc4. On apprend pourquoi le vietminh s’y installe et comment il y prospère, soutenu par la Chine communiste. Les postes isolés puis les garnisons plus importantes deviennent des pièges ; il est donc décidé d’évacuer par surprise Cao Bang, la plus éloignée, et de la faire recueillir par celle de That Khé. Le schéma semble simple. Mais l’ordre d’exécution tarde à être émis alors que le vietminh se renforce et, surtout, que le commandement ne perçoit ni la nature ni la qualité de ce renforcement. S’il est facile de faire porter l’échec aux exécutants sur le terrain, on perçoit déjà que le commandement possède une bonne part de responsabilité dans la catastrophe. Le haut-commandement français est bicéphale : le haut-commissaire civil et le général en chef. Au sein de la hiérarchie militaire, il y a les Indochinois, c’est-à-dire ceux qui sont restés longtemps sur le territoire, et les autres. Ivan Cadeau décrit particulièrement bien les rivalités, les atermoiements et surtout l’absence de sens de la présence française dans cette région. Au-delà des retards dont sont victimes les acteurs des colonnes Charton et Lepage, au-delà des difficultés de commandement des uns et des autres, au-delà de la nature particulière du terrain, la surprise du lecteur vient de la découverte du peu de prise en compte de la réaction vietnamienne, de la méconnaissance de l’ennemi qui, quant à lui, possède des objectifs politiques et militaires clairs ainsi qu’une forte adaptabilité.
La lecture de ce livre remarquable laisse une impression amère de gâchis, de morgue et de détresse humaine pesante. Un très bon ouvrage historique qui dessine en creux la méthode de raisonnement des états-majors français et peut donc aisément servir de support pédagogique pour toute personne qui s’intéresse à la façon dont on réfléchit une opération. Ivan Cadeau, progressivement devenu le spécialiste de la guerre d’Indochine, confirme ici ses compétences pédagogiques et ses qualités littéraires.