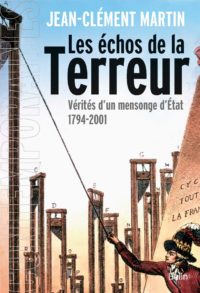
La Terreur révolutionnaire n’est pas un objet historique comme les autres : sa dénomination n’est pas une proposition d’historiens ; elle n’est ni une « période » ni une « notion » ni une doctrine, encore moins un « événement ». Elle eut certes une réalité historique – des violences qu’il ne s’agit pas de nier, de minorer ni même d’excuser –, mais elle n’eut pas une réalité politique avérée. Jean-Clément Martin préfère la qualifier subtilement de « catégorie de pensée », promise à de multiples avatars et plus encore à une extraordinaire fortune. Plus crûment, il s’agit bel et bien, dans sa version originelle, d’un « mensonge d’État », asséné par Tallien lors de son discours du 28 août 1794 pour désigner et stigmatiser une violence d’État terrorisant le pays tout entier, conçue comme l’expression organique d’un système de gouvernement et d’une ligne politique, en l’occurrence ceux de Robespierre et de ses amis, qu’il s’agit dès lors de disqualifier à jamais. Cette « invention » surgit à point nommé pour tenir lieu d’explication du présent et libérer l’avenir en même temps qu’elle dédouane tous ceux qui, au lendemain du coup d’État de Thermidor, entendent se maintenir au pouvoir. On peut lui contester sa valeur explicative – et même lui refuser toute propriété heuristique – sans méconnaître sa valeur performative, qui inaugura en quelque sorte la politique moderne. Telle est la thèse brillamment soutenue par Jean-Clément Martin dans ce nouvel opus d’une œuvre déjà considérable au sein de laquelle il apparaît comme le prolongement naturel de La Terreur. Vérités et légendes (2016).
Le propos s’attarde assez peu sur les conditions historiques de cette mystification – tâche entreprise par d’autres auteurs, tel Bronislaw Baczko –, pour leur préférer le détail de sa réussite. La fable de Tallien avait tout pour l’emporter auprès d’une opinion assez troublée du temps et déjà détachée du Comité de salut public pour laquelle elle revêtit une fonction autant thérapeutique et cathartique que proprement politique. D’autres facteurs, culturels ceux-là, l’accréditèrent aussi. Car la Terreur, d’emblée, fascina. La version qui en fut si opportunément et commodément proposée rencontra une sensibilité née de la révolution esthétique qui accompagne la Révolution depuis ses débuts, que dominent, notamment dans la littérature et le théâtre, la fascination morbide exercée par l’horreur et le goût du macabre, du fantastique ou de la monstruosité. Cette prééminence de la sensibilité sur les idées s’enracine aussi dans le terreau non moins fertile de l’engouement pour le « sublime », qui développe un langage des émotions permettant de comprendre l’incompréhensible.
Surtout, la Terreur, perçue comme la radicalité extrême de l’expérience révolutionnaire, possède une valeur symbolique ou symptomatique, qui devait en faire d’emblée un moteur de l’histoire. C’est à cette question que Jean-Clément Martin réserve le gros de sa démonstration, soulignant qu’il s’agit dès lors de s’intéresser à ce que la Terreur révèle de la Révolution et, plus encore, à ce qu’elle révèle de la lecture de la Révolution chez toux ceux qui en ont tenté l’analyse, favorablement ou non. Pour les historiens, notamment, l’exégèse du récit imaginé par Tallien permet d’écrire aussi bien de l’histoire que sur l’Histoire. Au-delà de leur exemple, mais d’une façon semblable, philosophes, artistes, écrivains et hommes politiques de toutes espèces ont inlassablement décliné la Terreur au gré de leurs passions et de leurs convictions. Cette difficulté des intellectuels à échapper à tout prosélytisme militant explique assez que, du fait même de sa plasticité, la Terreur devint très vite un objet polymorphe et mal identifié propre à qualifier des phénomènes en réalité fort différents. Ces lectures et ces interprétations, souvent contradictoires, qui n’ont cessé de s’accumuler deux cents ans durant, portent des échos qui façonnent toujours notre imaginaire collectif et entretiennent des confusions, des amalgames, voire des oublis sélectifs. La tâche, en effet, n’est pas aisée pour ceux qui, depuis la fin du xviiie siècle, revendiquent l’héritage révolutionnaire ou bien le refusent. Comment penser la Terreur dans son historicité, dans sa factualité, sans porter de jugement ? Sans évoquer les acteurs et les responsabilités ? Comment traiter de la violence dans le processus révolutionnaire en s’en tenant à des logiques impersonnelles ? Comment concilier l’embarras devant la Terreur et l’enthousiasme devant la Révolution ? Comment reconnaître l’excès sans le condamner ni l’excuser ? Les marxistes ne se montrèrent guère à l’aise dans l’entreprise. Les romantiques non plus, qu’une schizophrénie partagea entre condamnation de l’inexcusable et reconnaissance de l’énergie impulsée au pays. Les penseurs contemporains partagent encore ces embarras.
Ce livre, on l’aura compris, traite des résurgences et des réinterprétations du passé que le présent incessamment provoque. Il apprend et force à réfléchir. Il rappelle aussi qu’il n’est pas de sujet « sensible » dès lors qu’une ascèse, faite de prudence, de rigueur et de méthode, protège l’historien des pièges tendus par les bons esprits amateurs de scandales enfouis et de polémiques médiatiques.