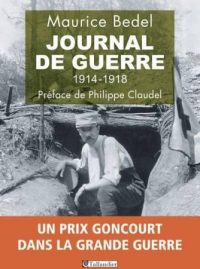
Un journal de guerre tenu par un médecin, écrivain et fin observateur des réalités. Un journal de guerre qui (ils sont finalement peu nombreux dans la masse des publications) nous entraîne du 1er août 1914 au 15 décembre 1918.
Dans sa présentation de l’auteur, Chantal Verdon utilise abondamment les carnets et autres écrits d’avant 1914 et d’après 1918 afin de nous présenter celui qui fut aussi un grand défenseur de la langue française, ce qui permet de mieux cerner sa personnalité. Médecin aide-major au 170e RI, la première phrase de la première page de son journal, à la date du 1er août, donne le ton : « Dans le train qui m’emporte vers Nancy tout le monde est ivre. » Homme cultivé, Maurice Bedel ne se sent pas à l’aise au milieu de cette populace qui « gueule » La Marseillaise. Néanmoins, « tous nous avons la gaîté au cœur et la certitude de la victoire » (2 août). Les portraits de ses chefs, de ses pairs ou de ses hommes qu’il dresse au fil du temps sont rédigés avec la même franchise et le même style direct, de même que pour les Territoriaux, « affolés par leur responsabilité ». À partir du 23 août, la tonalité change : ce sont les premiers trains chargés de blessés puis la retraite, « lugubre », et les combats autour de Rambervillers. Commence alors une série de visites, plus ou moins spontanées, aux premières lignes (« Je suis retourné à la bataille, malgré la consigne. C’est d’ailleurs un plaisir de plus que d’y aller en désobéissant ») et la description de ce qu’il voit ou de ce que l’on lui raconte. Après une brève contre-offensive en direction de Baccarat à partir du 12 septembre, voilà dès le 15 l’organisation défensive du terrain et le 17 septembre « la guerre, c’est un jeu de cache-cache où les cachettes sont des tranchées ». Tout en assurant son service de médecin, régulièrement il « cherche une ruse pour s’approcher de la ligne de feu » et ces allers et retours permanents entre l’extrême avant et l’immédiat arrière-front nous donnent des descriptions saisissantes des fantassins ou des artilleurs.
Les Vosges, la Meuse, l’Aisne : entre les bombardements et les périodes en réserve à l’arrière, Maurice Bedel saisit la moindre opportunité pour se déplacer, voir d’autres lieux, d’autres personnes, d’autres formes de la guerre. Au fil des pages aussi, « la monotonie de ces jours de guerre durant lesquels il se tire à intervalles éloignés un coup de canon par-ci, un coup de canon par-là ». Mais bientôt, le retour aux tranchées, et cette alternance de séjours en ligne et de journées à l’arrière, avec des descriptions toujours différentes selon les lieux et les temps. Blessé en 1915, Bedel est évacué vers Lyon pendant que son régiment est dans les tranchées de Notre-Dame-de-Lorette. Un congé de convalescence de deux mois, qu’il supporte parfois difficilement loin de ses hommes et de ses camarades, et le retour à la fin du mois d’août : « Tous les officiers supérieurs du bataillon ont été tués ou évacués comme incapables. Les capitaines tués. Et tant de lieutenants ! Que reste-t-il de tous ces anciens ? » C’est ensuite le front de Lorraine, la pluie avant la neige et le verglas, la description des nouveaux matériels d’artillerie lourde, celle des gaz de combat et celle des travaux qui accompagnent les préparatifs d’une attaque. Le 23 février, il note qu’à « cent cinquante kilomètres du champ de bataille, la terre tremble, l’air est lourd de bruit » : c’est Verdun. Tout en pratiquant le ski, il commente le communiqué officiel, décrit les combats autour du linge, l’inanité de la presse parisienne : « Le journaliste a toujours flatté l’appétit sanguinaire du public. » Allant du poste de secours en ambulance de l’avant à l’arrière, il voit tout dans son secteur et note tout. Ses propos se font de plus en plus critiques ou pessimistes, mais il ne renonce pas pour autant à sa curiosité d’esprit.
Au début de septembre 1916, on lui annonce son départ pour le Maroc et il quitte ses tranchées (« Enfer, tu m’as élevé au-dessus des misères. Tu m’as élevé également au-dessus de la pitié. Et cela, Enfer, je ne te le pardonnerai jamais. »). Il y arrive le 15 pour être affecté à sa demande « au 3e bataillon de tirailleurs marocains qui opère dans le Moyen-Atlas ». Dans un tout autre environnement, avec des soldats bien différents et à l’occasion d’engagements qui relèvent de la pacification (parfois rude), il poursuit son récit, multiplie les descriptions, sur les habitations, les modes de vie, les opérations et le quotidien des groupes mobiles. En mai 1917, c’est le retour dans l’Hexagone, une tentative de torpillage de son navire et la description de Gibraltar où « la puissante Angleterre est là qui veille ». C’est alors le front de l’Aisne : « L’Allemand a condamné ce pays à la peine de mort. Le pays a été exécuté ; et la terre est morte, et les maisons sont mortes, et les rivières sont mortes, et les champs sont morts. » Un séjour à Soissons avant le Moulin de Laffaux, les offensives allemandes du printemps 1918, l’arrivée des Américains et, le 20 juillet, les premiers échos de la contre-offensive de Villers-Cotterêts. Le ton change, les phrases deviennent brèves, la guerre de mouvement reprend. Le 13 octobre, on annonce que les Allemands acceptent de discuter des conditions de paix. Désormais, quelques mots jetés rapidement sur le papier entre deux informations (ou rumeurs) sur les conversations d’armistice. Le 10 novembre encore : « La guerre sera longue, mais la victoire est sûre. » Mais rien le lendemain 11, rien avant le 15 novembre pour noter le décès d’un proche six semaines plus tôt. Et à aucun moment dans les dernières lignes il n’écrit le mot paix ou un quelconque synonyme.
Un très beau et très grand témoignage qui doit impérativement être connu de tous les amateurs, étudiants, chercheurs. Dès à présent un incontournable.