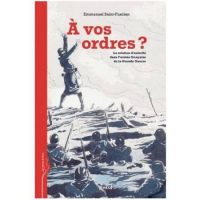
Cet ouvrage étudie la relation d’autorité dans l’armée française de la Grande Guerre — à vrai dire, sur le front de l’Ouest et dans l’infanterie, avec une étude particulièrement fouillée de la 3e DI. C’est une thèse, avec toutes les grandeurs et les servitudes du genre. On se félicite d’y suivre un parcours exhaustif des sources classiques : les livres, « causeries » et articles qui, de 1890 à 1925, attestent de l’obsession des figures de l’autorité et des enjeux de l’obéissance chez nos militaires, à l’heure civile des « hussards noirs » dans les écoles publiques, de la taylorisation dans l’entreprise de Freud et de Max Weber ; les témoignages et les récits de guerre ; les archives du contrôle postal et celles des jugements rendus par les conseils de guerre, ordinaires ou non, de la 3e DI ; la masse des documents de principe conservés au Service historique de la Défense. On y approuve un mixage habile de l’étude chronologique des mutations (la guerre elle-même fait évoluer), et du rappel des héritages et des permanences. On y vérifie la solidité d’hypothèses de travail de plein exercice historiographique, puisque la question du consentement des soldats à la discipline imposée divise toujours les historiens de la Grande Guerre.
Donc, de belles et bonnes sources, un beau projet : tous les éléments de la réussite étaient réunis. On s’en persuadera au fil de la lecture de ce livre toujours bien étayé, bourré de références et de détails qui en disent long. Ainsi, ces pages 88-97 où sont détaillés les nouveaux attributs de l’autorité de l’officier, loin du rôle ancien des galons, du revolver, du sabre et du sifflet : la canne qui distingue, la pipe qui rapproche, la montre-bracelet scrutée avant l’attaque, la jumelle qui identifie l’ennemi, le téléphone de campagne.
Des conclusions ? 70 % des refus d’obéissance ont eu lieu au cantonnement ou alentour, mais ils furent « insignifiants » (soixante-seize soldats de la 3e DI sur trente mille), car les hommes ont obéi massivement. Les conseils de guerre en 1914-1915 furent autrement plus durs qu’en 1916-1917. Les officiers et les sous-officiers aussi ? Le livre ne répond guère à la question. Ils partageaient avec les nouvelles élites républicaines l’obsession d’une autorité renouvelée, fondée sur la compétence, l’efficacité et l’exemple, mais cette guerre nouvelle leur a imposé une constante mise à bonne distance, une sorte d’accommodation, car « la guerre a créé une topographie mouvante des exercices de l’autorité », au feu, dans la tranchée ou au cantonnement, et les refus d’obéissance intervenaient le plus souvent lors du passage d’une activité à une autre. L’autoritarisme fut plus fort au début du conflit qu’à la fin, et l’adhésion des hommes à cet autoritarisme aussi.
Mais tout au long, « l’autorité a dû s’adapter au niveau d’adhésion des hommes », tant l’activité combattante au front fut « dé-hiérarchisante » et imposa une pratique plus souple de l’autorité, puisque le chef n’a pu s’imposer qu’à l’aune de sa capacité technique et de sa valeur guerrière, qu’à force d’être devenu une personne plus qu’un principe, un exemple suggestif, et même une fascination, plus qu’un ordre hiérarchique. Et ce fut exactement l’inverse à l’arrière, où l’on songea d’abord à « visser » à l’ancienne, territoriaux compris, dans les casernes et entrepôts. Au point qu’Emmanuel Saint-Fuscien nous fait relire le chef d’escadron Charles de Gaulle qui avait compris, lui aussi, que l’autorité militaire, si terriblement rebaptisée par la Grande Guerre, devenait un « fait affectif » et que « le prestige grandit et multiplie les effets de la Discipline par une suggestion morale qui dépasse le raisonnement ».