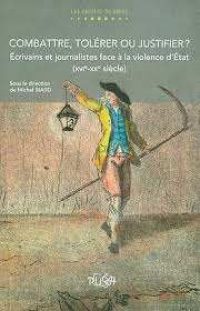
Violence et identité entretiennent des rapports divers et multiformes que les historiens ont été amenés, depuis plusieurs années, à interroger et à analyser. Plusieurs travaux ont ainsi montré le rôle de la violence – notamment celle, illimitée selon Clausewitz, qui se déploie lors des conflits – dans la structuration et l’évolution des identités. De même, la violence peut être le reflet de l’identité. Ainsi, le groupe de recherche d’histoire de l’université de Rouen (grhis), qui étudie les pratiques et les formes de sociabilité dans leur évolution historique, et qui, depuis une dizaine d’années, travaille plus précisément sur la construction des identités, s’est proposé, lors d’une de ses journées d’études, de réfléchir au rôle de « témoin face à la violence » que les hommes de plume ont tenu au cours de l’histoire. Ce numéro des Cahiers du grhis regroupe les huit contributions de cette journée dans la perspective de « mieux appréhender l’une des facettes de l’homme de plume, qu’il soit écrivain ou journaliste ».
Cependant, si la narration de la violence est au centre de cette « réflexion à plusieurs voix », il s’agit d’une violence spécifique : la violence d’État. Hannah Arendt souligne le caractère fondamentalement prééminent du pouvoir sur la violence : celle-ci doit être comprise comme l’instrument de celui-là. Or c’est bien l’emploi de la violence comme moyen du pouvoir qui est présent dans les récits étudiés au sein des différentes contributions proposées par le grhis. Le choix qui a été fait dans l’organisation de cette réflexion de centrer le propos sur la violence d’État se révèle être, en pratique, tout à fait judicieux. Il permet d’éviter le piège de l’objet trop ambitieux que serait la violence en elle-même et dans son intégralité. De plus, la violence d’État apparaît comme un objet d’études d’une grande richesse, ce dont témoigne la diversité des contributions.
L’État est, selon Max Weber dans Le Savant et le Politique, la seule institution pouvant légitimement faire usage de la violence pour exercer son autorité. Cette définition permet de mettre en évidence plusieurs aspects tout à fait intéressants des contributions proposées. Tout d’abord, telle qu’elle se déploie dans un certain nombre de situations, cette violence pose la question de l’État lui-même. C’est notamment ce que montre Bernard Gainot dans son analyse de l’écho trouvé en métropole par la révolte des esclaves de Saint-Domingue en août 1791 : dans la situation particulière qu’est le contexte révolutionnaire français, « qui doit prendre la décision de l’emploi de la force coercitive » ?
Dans une perspective historique très différente, mais qui pose finalement une question comparable, les violences de l’épuration dont Jean-Claude Vimont fait mention témoignent des difficultés à rétablir la légalité républicaine à la Libération. Ainsi, il semble que réfléchir sur la violence d’État amène les historiens à penser l’État, notamment dans ses moments de crise et de mutation. De plus, l’étude de la narration de la violence d’État permet aux auteurs d’aborder l’État dans la diversité des formes qu’il a prises dans le temps et dans l’espace : monarchique, révolutionnaire, démocratique, totalitaire…
Enfin, comme le suggère la définition wébérienne, l’analyse du récit de la violence d’État amène tous les auteurs des contributions réunies à montrer qu’un des enjeux fondamentaux pour les hommes de plume – quels que soient l’époque et le pays étudiés – est la question de la légitimité ou non de la violence d’État rapportée, mais aussi, de façon indirecte, celle de la légitimité ou non de la violence vis-à-vis de l’État : légitimité de la violence pendant les guerres de Religion, illégitimité de l’État monarchique qui déclenche la guerre civile en faisant le siège de Paris en 1649, légitimité de la République en danger contre les Vendéens en 1793, violence illégale mais légitime de l’armée prussienne à Sedan légitimant la guerre de francs-tireurs, mise en cause de la légitimité, voire de la légalité, par les collaborateurs épurés.
À la lecture de ces différents travaux – tout aussi ponctuels aux plans spatial et temporel qu’ils soient –, il apparaît que le rapport à la violence d’État, tel qu’il ressort des écrits des hommes de plume, évolue, et ce notamment en relation avec la question de la légitimité. En effet, l’une des problématiques qui se dégagent est celle de savoir quand et comment la violence comme instrument de gouvernement est devenue illégitime aux yeux des hommes de plume et de leurs contemporains. Ce questionnement relatif à la violence d’État apparaît alors comme un moyen d’aborder la violence dans son ensemble et l’évolution de la perception que les individus en ont.
Dès la première phrase de son introduction, Michel Biard affirme que « la violence d’État est omniprésente dans de très nombreux pays du xvie siècle à nos jours ». Or les huit contributions nous permettent de saisir, par leur diversité temporelle – trois sur la période moderne, deux sur la période révolutionnaire, trois sur la période contemporaine – et spatiale – six portent sur la France, une sur la monarchie espagnole des Habsbourg, une sur l’Autriche –, la multiplicité des formes prises par la violence d’État. En effet, la guerre n’est qu’une forme extrême parmi les différentes modalités de la violence qu’engendre l’État. Ainsi, cette violence est militaire, mais aussi policière – lors des arrestations des girondins à l’été 1793, comme le montre Michel Biard, ou lors de celles de journalistes juifs ou de gauche à la suite de l’Anschluss, comme l’expose Paul Pasteur –, judiciaire – lors de la criminalisation des opposants politiques en France dans les années 1940, comme l’analyse Jean-Claude Vimont.
De plus, la violence d’État est aussi une violence répressive, utilisant les différents moyens de coercition à sa disposition face à ceux qui se révoltent ou s’opposent. Dans cette perspective, plusieurs contributions permettent d’aborder une violence d’État à caractère militaire, mais ne se déployant pas contre un ennemi extérieur au territoire : les études proposées sur la période moderne et révolutionnaire apparaissent comme des jalons possibles à une réflexion plus large sur la notion de guerre civile. Ces analyses permettent de saisir les attitudes complexes des hommes de plume face à une violence militaire répressive. Enfin, cette violence peut être politique, se déclinant dans les contributions de la fuite du roi en 1649 à la violence extrême de l’État hitlérien. Et Pierre-Jean Souriac nous rappelle qu’elle peut être religieuse, à l’image des affrontements que la France a connus au xvie siècle.
L’objet commun des huit contributions réunies dans cet ouvrage est le « discours sur cette violence d’État ». Ce discours est le fait d’hommes de plume très différents et résulte d’une grande diversité dans les modalités d’écriture. La violence d’État telle qu’elle nous est donnée à voir dans ces différentes études est une violence infligée ou vécue, subie ou observée. Le point commun à toutes ces analyses est qu’elles portent sur une violence d’État narrée, mais à des moments différents de son déploiement – avant, pendant ou après –, alors que cette violence a été constatée, directement ou indirectement. Pourtant, si les hommes de plume sont des témoins face à l’usage de la violence par l’État, ils sont aussi des acteurs : le travail d’Odile Roynette met, par exemple, en question l’influence de cette implication. Il s’agit alors de cerner différentes attitudes d’hommes de plume face aux différentes formes que peut prendre la violence d’État, ces différentes attitudes se déclinant de l’opposition à la justification, comme en témoigne le titre de l’ouvrage – combattre, tolérer, justifier.
Dans « Juger la guerre civile. Écrire l’histoire des troubles religieux dans la deuxième moitié du xvie siècle », Pierre-Jean Souriac se propose d’aborder la question du discours sur la violence d’État par « un questionnement sur la construction du récit historique produit durant et juste après les guerres de Religion ». Pour ce faire, il a constitué un corpus d’une cinquantaine d’ouvrages publiés dans la seconde moitié du xvie siècle et qui ont eu l’ambition de traiter de l’histoire des troubles, de manière partielle ou globale, mais avec le recul d’un regard a posteriori.
La dichotomie légitimité/illégitimité de la violence est aussi au cœur de l’analyse que propose Katia Béguin de la fuite du jeune Louis XIV accompagné de la régente Anne d’Autriche et du cardinal Mazarin, quittant Paris en janvier 1649 avant d’en organiser le siège : « La fuite royale de 1649 : une violence d’État oubliée ». Cette contribution montre que, contrairement à ce que les historiens ont longtemps cru, cette fuite n’est pas une manifestation de faiblesse du pouvoir monarchique, mais le prélude au déploiement d’une violence d’État extraordinaire qui témoigne presque du contraire.
Si Katia Béguin analyse dans le cadre français une violence politique préfigurant une violence répressive, Alain Hugon se penche, lui, sur le récit d’une violence répressive dans les espaces de la monarchie espagnole. Alain Hugon évoque lui aussi dans l’étude qu’il propose – « Les violences au cours de la révolte napolitaine (1647-1648) et des révoltes andalouses (1647-1652) » – le phénomène qui voit la violence d’État engendrer la révolte et donc les violences de la guerre civile. Les trois contributions des modernistes confirment que la dénonciation de la violence comme instrument du pouvoir n’est pas d’actualité jusqu’au xviiie siècle.
Il est intéressant de constater qu’un siècle et demi plus tard, la perception de la violence d’État dans la France révolutionnaire témoigne d’un changement des mentalités. C’est notamment ce que nous apprend la contribution de Bernard Gainot sur l’écho dans la presse métropolitaine de la révolte des esclaves de Saint-Domingue les 22 et 23 août 1791 : « La presse métropolitaine et la violence coloniale en novembre 1791 ». Comme les contributeurs précédents, il constate une grande différence du point de vue du récit des violences avec les narrations postérieures qui insistent sur les anecdotes sanglantes. L’enjeu fondamental est celui du rétablissement de l’ordre, et à travers lui se pose la question de la situation de l’exécutif, car l’incertitude quant au lieu à partir duquel se déploie l’appareil coercitif de l’État caractérise ce moment de la période révolutionnaire, l’historien résume ainsi cette question : « Où est l’État ? »
Michel Biard, pour sa part, s’attache aux écrits d’un journaliste peu connu, Antoine Lemaire, publiés dans Le Courrier de l’égalité au cours de la première moitié de l’année 1793 – « Lemaire et le Courier de l’égalité. Les évolutions d’un journaliste “brissotin” face aux violences politiques (printemps-été 1793) ». Il s’agit pour lui de saisir les évolutions d’un journaliste face à la multiplication des formes prises par la violence engendrée par la radicalisation de la Révolution. Ainsi, celui qui prêchait conciliation et modération à l’été 1792, allant jusqu’à condamner la peine capitale, adopte à l’été 1793 une attitude de tolérance voire de défense de la violence exercée par l’État révolutionnaire. En quelques jours, à partir de l’annonce du soulèvement vendéen – annonce le plus souvent déformée et amplifiée –, Lemaire en appelle à l’usage des armes pour écraser les rebelles et réclame désormais la plus grande sévérité. La République mise en danger, l’usage de la violence lui apparaît désormais légitime.
Dans une perspective très différente, Odile Roynette montre, elle aussi, comment le déchaînement de la violence subvertit les certitudes et les convictions – « Écrivains et journalistes, témoins et acteurs de la violence de la guerre (Sedan, 1870) ». En prenant comme sujet un des combats les plus meurtriers du xixe siècle européen, cette contribution est la première à s’intéresser à la guerre en tant que « guerre étrangère » et aux violences qu’elle engendre. Avec Sedan, les simples comptes-rendus deviennent des récits dénonciateurs : de témoins, les journalistes se muent en acteurs du conflit. Le spectacle des violences de guerre bouleverse leurs certitudes – à l’image des violences révolutionnaires pour un Antoine Lemaire –, ébranle leur éthique professionnelle et entraîne, semble-t-il, une redéfinition de leur identité d’intellectuels.
La confrontation avec la violence multiforme que mettent en œuvre les États totalitaires, notamment à l’encontre des hommes de plume, est sans doute, au xxe siècle, l’un des facteurs principaux de bouleversement et de traumatisme identitaires. C’est ce que Paul Pasteur s’attache à montrer dans son analyse du cas particulier de la mise au pas, à partir de mars 1938, des journalistes et des écrivains – « S’adapter ou résister ? Les journalistes et écrivains autrichiens et l’Anschluss ». Ainsi, dans le cadre de son étude sur les révoltes andalouses et napolitaines, Alain Hugon écrit une phrase qui trouve encore confirmation quatre siècles plus tard : « On peut considérer l’exil, la censure, l’accaparement et la destruction d’archives comme autant d’actes d’une violence exercée par les autorités, sinon envers les journalistes et écrivains, du moins à l’égard de ceux qui transmettent la mémoire collective. » Paul Pasteur rappelle qu’il ne faut pas sous-estimer le nombre de journalistes et d’écrivains autrichiens qui étaient nationaux-socialistes.
Enfin, Jean-Claude Vimont avec « Les pamphlets d’épurés incarcérés après la Libération », propose de renverser totalement les perspectives adoptées depuis les premières contributions : face aux récits d’une violence d’État justifiée, tolérée, minimisée, tue, voire ignorée, il se propose d’étudier le récit excessif d’une violence d’État exagérée et outrée par ceux qui en rendent compte. Ainsi, écrivains et journalistes épurés et incarcérés à la Libération tentent, par leurs écrits, d’assimiler une violence à une autre afin de démontrer l’illégalité et l’illégitimité de la violence d’État qu’ils ont subie, et dont la réalité, malgré les excès et les problèmes de la Libération, est bien éloignée du tableau qu’ils en font.
Cette dernière contribution illustre, de façon peut-être encore plus frappante que les autres, le fait que toute narration de la violence d’État est au service de l’objectif que le narrateur s’est donné. La narration manifeste des représentations maîtrisées et inconscientes de la violence. De plus, l’idée d’une modification, parfois radicale, entre les discours contemporains et les discours formulés a posteriori sur la violence ressort de l’ensemble des analyses proposées. Enfin, l’étude, au travers de ces différentes contributions, du discours élaboré par des hommes de plume sur la violence d’État permet de saisir une des caractéristiques fondamentales de la violence, expliquant notamment son impact identitaire, à savoir son caractère profondément subversif.