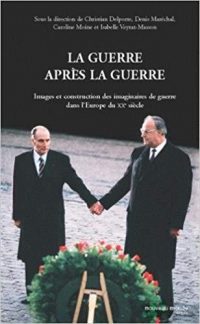
Au prisme de la temporalité, la réalité de l’événement vécu par les contemporains se transforme. Construite et reconstruite, sa représentation devient alors inséparable des relations entre la mémoire collective et la mémoire individuelle : si la « mémoire entretient des rapports mystérieux avec l’oubli, elle est également le ferment d’un discours sans cesse actualisé sur l’événement ». Et si simultanément ce dernier était interrogé à travers le prisme du visuel ?
En cela, le titre de l’ouvrage parle de lui-même. Prolongement d’un colloque qui s’est tenu à l’Institut national de l’audiovisuel à Paris en 2007, l’originalité de La Guerre après la guerre. Images et construction des imaginaires de guerre dans l’Europe du xxe siècle réside dans une projection qui se situe « bien au-delà de l’événement » et qui prend appui sur un outil d’observation à la fois singulier et polymorphe : l’image. Destinées à un large public, de l’initié au lecteur amateur s’interrogeant sur la construction des imaginaires de guerre, les contributions diversifiées des chercheurs français et étrangers qui forment le corps du livre s’articulent autour d’une question centrale : comment, la paix revenue, les images (celles laissées par la guerre ou édifiées après la guerre pour en faire le récit) contribuent-elles à nourrir les imaginaires collectifs sur la guerre passée ? Privilégiant la méthode du comparatisme international, le mouvement de pensée prend pour origine l’« univers visuel du traumatisme et observe la façon dont il se transforme, s’enrichit ou s’appauvrit parfois, jusqu’à bouleverser l’interprétation de la guerre elle-même ».
Les articles qui constituent la première section (« Des images pour exprimer le traumatisme ») interrogent tour à tour le rôle des images dans l’expression du traumatisme : saisies par le temps, les « images-témoins » des atrocités de la guerre composent avec des images plus optimistes. Placés en situation d’« uchronie », l’« acteur » et le « spectateur » sont ainsi appelés à se tourner vers le futur immédiat.
L’étude de la « bataille » de Verdun est, à ce titre, éclairante. Analysée sous l’angle de sources cinématographiques qui couvrent l’ensemble du siècle, celle-ci met au jour le passage de l’événement vécu au lieu de mémoire : progressivement la notion de « bataille » semble comme s’étirer pour « englober le souvenir et peut-être même la mémoire de l’événement ». Sous la juridiction du temps qui le problématise, l’événement Verdun devient un « micro-événement » Douaumont, qui, pris et repris par chaque récit filmique, se transforme en lieu de mémoire symbolique de l’« après-bataille » : en 1984, soit soixante-dix ans après le début de la Première Guerre mondiale, François Mitterrand et Helmut Kohl rendent hommage aux disparus devant l’ossuaire.
L’érection d’édifices commémoratifs qui accompagne un « deuil impossible » contribue ainsi à la cristallisation de la mémoire. Dans ce contexte, les salons, « plaque tournante du commerce des monuments aux morts », constituent une source de renseignements précieux qui invite à s’interroger sur les valeurs prônées par la « culture de guerre ». Chacun des statuaires, combattants et non-combattants, a ainsi livré les « images de la guerre après-guerre » : expression du « deuil courageux de la nation », ces représentations étaient directement destinées à rendre hommage et à porter la mémoire des disparus. Images chargées de sens nées de la culture de guerre, les allégories pacifiques ou guerrières, qui dominaient la commande commémorative officielle, rappellent la permanence d’une imagerie héritée de la IIIe République. Conjointement, celle-ci renseigne sur une « culture esthétique et iconographique », née du savoir-faire d’artistes statuaires empreints de la culture antique et médiévale.
La puissance émotionnelle et la force de suggestion exercée par l’image en font à la fois un instrument formidable et redoutable. Les contributions de la deuxième partie (« Des images pour reconstruire et commémorer ») éclairent cette bipolarité : si les images à caractères traumatiques sont rares puisqu’il s’agit de rappeler la guerre par les vivants qui honorent les défunts, le recours à l’imagerie de propagande est un usage courant dans le processus de reconstruction nationale. Processus qui se déploie selon deux dimensions : morale et matérielle.
C’est à l’aune de la première que l’étude des cérémonies italiennes du soldat inconnu contribue à éclairer la compréhension de ce processus. La place prééminente occupée par les femmes en deuil apparaît comme le « résultat d’une construction socioculturelle et politique souvent très précise » : la douleur « privée » est utilisée publiquement lors des différentes phases du cérémonial « comme une sorte d’énergie à haut potentiel ». Symbole culturel et religieux, l’image allégorique de la femme « fondamentalement mère, génitrice des combattants (présents et passés) et des fils des combattants (l’avenir de la nation) » compose avec celle de la nation « mère de toutes les mères ». Cette importance symbolique sera activement relayée par la presse durant toute la période des cérémonies. Mais si la participation officielle des femmes-mères lors des cérémonies publiques est prévue, elle est surtout organisée et réglementée par les autorités publiques, laissant ainsi apparaître une sorte de « hiérarchisation du deuil ». Et pourtant, cette énergie doit pouvoir être canalisée, car elle est potentiellement dangereuse : si l’image peut être utilisée, elle peut aussi être instrumentalisée. En 1925, la création de l’Institut national pour la protection de la maternité constituera une des étapes significatives vers l’institutionnalisation du fascisme.
Parallèlement, la « reconstruction matérielle » des bâtiments « historiques » apparaît comme une autre étape importante de ce processus. La diffusion des images de ruines se présente comme un défi posé à la population : « Surmonter les traumatismes du conflit. » La reconstruction (1945-1955) de la cathédrale de Saint-Étienne et de l’Opéra d’État de Vienne en Autriche joua un « rôle émotionnel » essentiel dans l’imaginaire collectif, dont les étapes devinrent une sorte de « baromètre de la croissance de la conscience d’une identité nationale auprès de la population et du monde ». Alors que ces bâtiments n’étaient pas essentiels à la survie de la population, ils ont cependant bénéficié du soutien financier et de la participation active de celle-ci. Une nouvelle fois, le « travail médiatique » manipulant les images, mais aussi le son et l’émotion du direct joua un rôle central dans le processus de reconstruction de ces édifices qui progressivement dépassèrent la « condition de simples édifices historiques » pour accéder « au statut d’institutions ».
En fil d’Ariane se dessinent peu à peu les contours de la problématique de l’intégration de l’événement passé dans le présent. Tel apparaît précisément le dessein de la troisième section (« Guerres passées conjuguées au présent »). À cet effet, l’étude des productions cinématographiques espagnoles de l’après-guerre civile rend compte de la difficulté à construire un discours cohérent sur un passé qui ne le fut pas. En Espagne, dès la mort de Franco, la guerre civile apparaît comme un thème récurrent du cinéma de la démocratie dont l’enjeu est de proposer « une vision plus exacte, moins partisane de la guerre ». Bien que la lecture de l’événement soit effectivement revisitée, la nouvelle version demeure tributaire d’une démocratie qui se cherche et qui rencontre les limites de ce qu’il est autorisé de dire et de montrer : la filmographie de la période de transition montre des positions idéologiques gommées et l’image d’une guerre édulcorée. Cette dépolitisation concomitante à l’esprit du temps (« plutôt l’accord que l’affrontement ») laisse de côté les valeurs fondatrices de la République comme de la démocratie. Et après 1976 ? La censure disparue, les productions réintroduisent certaines réalités occultées par la dictature, mais la « dilution des cultures politiques » et de la violence persiste comme si la société rencontrait des difficultés « à regarder avec sérénité un passé [la République] auquel elle a renoncé pendant presque quarante ans avant de se donner à nouveau un régime démocratique ».
Les temps du souvenir et de l’oubli sont concomitants. En filigrane s’affirme progressivement la question du rôle de l’image dans la transmission des événements passés aux générations présentes et à venir. Tel est précisément l’objet de la dernière partie (« Restituer, reconstituer la guerre : entre mémoire et histoire »), qui éclaire le lien à la fois convergent et contradictoire qu’entretiennent mémoire et histoire.
Construites a posteriori, les expositions des musées d’histoire participent à définir le regard porté sur les morts dues aux guerres. Parmi « ces représentations qui « visibilisent » la mise en abîme de la relation quotidienne entre les morts et les vivants », différents types de mises en images peuvent être distingués : la représentation « métaphorique » figure les disparus par des effets personnels et des objets courants leur ayant appartenu mais qui survivent hors contexte, tandis que, dans la seconde représentation, les morts sont figurés par des formes humaines mises en mouvement, ou par la forme d’un corps morcelé. Enfin, la dernière dimension fonctionne selon un « processus de déterritorialisation » qui « décontextualise » le corps ou « dé-corpore » les morts (exposition des urnes). Conjuguant présence et absence, ces mises en images questionnent « notre relation à la mort violente et collective » ; sans ces traces l’« événement n’est rien ». Générant des manifestations qui « lisent le passé qui s’éloigne à la lumière du présent », les « dates anniversaires » contribuent à la transmission de la mémoire de celui-ci.
La guerre d’Algérie n’échappe pas à cette règle. L’étude filmique de ce sujet à part donne à voir l’image d’une guerre « progressivement deshistoricisée » : vue du côté des politiques puis saisie par les civils et par la mémoire, sous la révélation de la torture, la « question historique se fait philosophique, éthique », interpellant ainsi les contemporains sur la question plus large des droits de l’homme. Si, d’une manière générale, la mise en scène des images laisse au spectateur un choix plus ou moins libre d’interprétation, cette interprétation parfois tronquée, partielle et partiale interroge à juste titre les historiens sur la question de l’objectivité. Dans ce contexte, une « subjectivité de réflexion » est essentielle à chacun pour ne pas succomber à la « guerre des subjectivités ».
Par la densité, la qualité de ses analyses et les thèmes qu’elle aborde grâce à une approche croisée internationale, cette initiative est révélatrice de l’intérêt manifeste des chercheurs pour les questions qui traversent aujourd’hui la communauté scientifique mais aussi la société civile. Le sujet est loin d’être épuisé, ne serait-ce que parce que l’« histoire des guerres » n’est pas achevée et que la pluralité irréductible des « cultures de guerre » a encore beaucoup à nous apprendre.